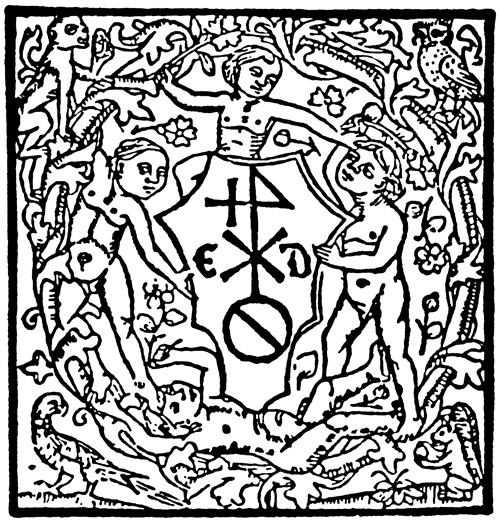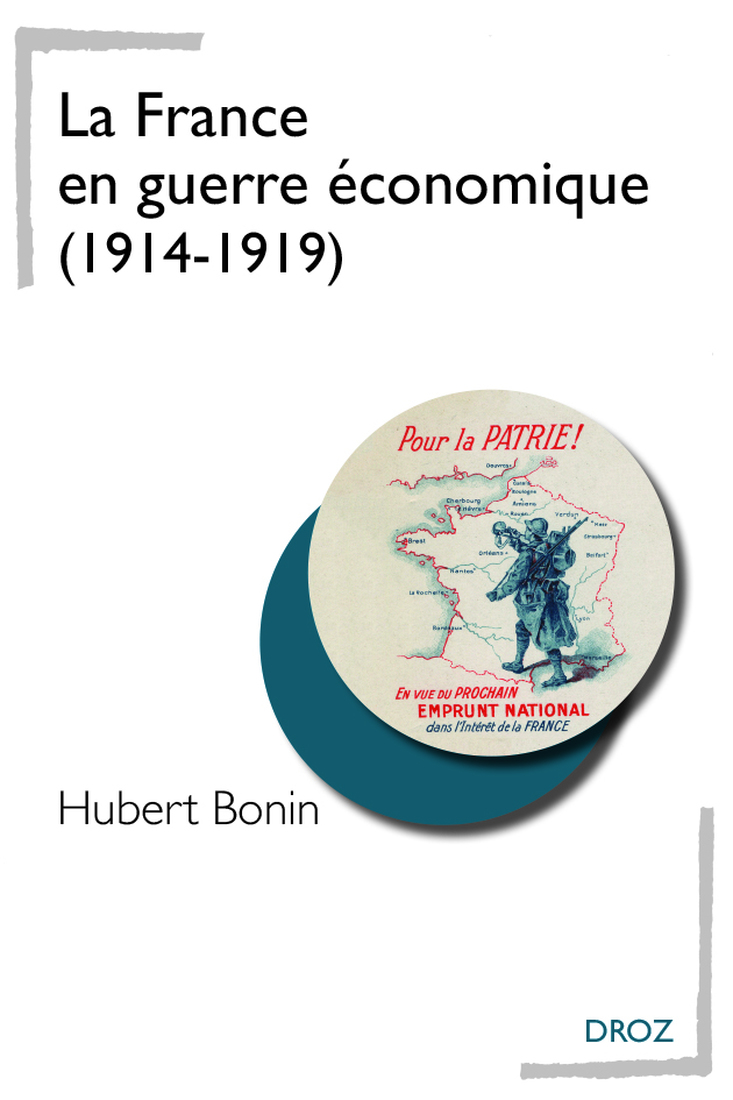

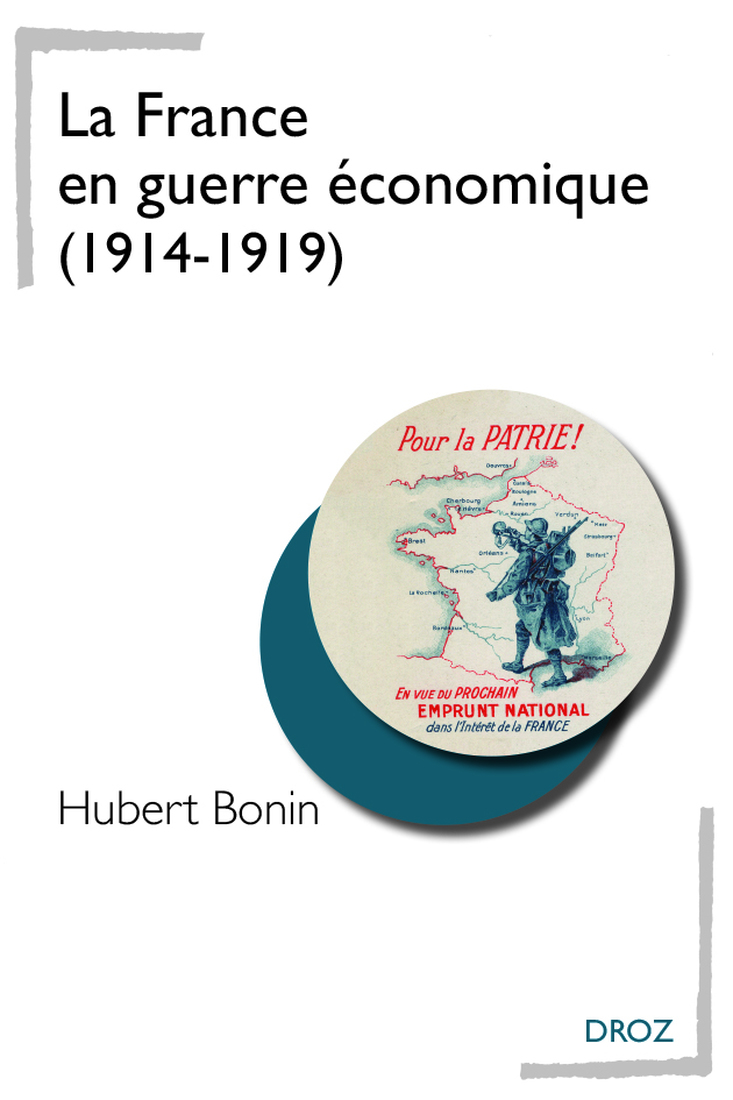
La France en guerre économique (1914-1919)
- Présentation
- Sommaire
- Presse et annexes gratuites
Afin de répondre aux demandes de plus en plus importantes et répétées des armées, l’industrie s’érige en vaste front de l’arrière. Des usines se reconvertissent ou sont créées ; les grandes entreprises deviennent des « firmes-pivots » structurant, au sein de chaque branche d’activité, de grands établissements, des pme et des sous-traitants. Des flux d’innovations se répandent dans l’artillerie, l’aéronautique, les chars, les méthodes de fabrication. La pénurie de produits de base, de charbon, de moyens de transport et de main-d’œuvre enraye ces processus ; une économie administrée se cristallise pour les surmonter. Il faut aussi financer les investissements et les besoins courants des entreprises et de la commande publique, d’où le rôle croissant des banques. Un enjeu clé est d’affûter la compétitivité des systèmes productifs nationaux et locaux afin de contrecarrer la puissance industrielle allemande au cœur de la guerre, puis de préparer la nouvelle Europe économique de la paix.
TABLE DES MATIÈRES
Avant-Propos, Lieutenant-colonel Rémy Porte
Introduction générale
- De la guerre matérielle ou industrielle aux esprits en guerre
- Une rupture avec l’esprit d’ouverture
- Des entrecroisements incessants
- Tout serait dit ou écrit ?
- Un nouveau type de guerre : de la guerre totale à la guerre économique
- Des systèmes productifs sectoriels et locaux à l’appareil économique d’Etat ?
- Des héros ou de grandes figures de la guerre économique
- L’argent, nerf de la guerre
Première partie La guerre industrielle de la Nation
Chapitre premier. Bordeaux, capitale de la mobilisation industrielle (20 septembre 1914)
- Bordeaux au coeur des choix stratégiques en septembre 1914?
- La mobilisation industrielle classique
- Des débats autour de la stratégie militaire française A. Edmond Buat, un témoin clé B. Une inflexion sous la pression des événements
- Trois réunions d’industriels à Bordeaux
- Le lancement de la guerre industrielle Conclusion
Chapitre II. La montée en puissance de la machine de guerre industrielle : vers une économie mixte (1914-1919)
- Une maturation trop lente de l’outil productif (de l’automne 1914 à l’été 1916) A. Les blocages de l’été 1914 B. Les premières réactions après la prise de conscience de l’impasse économique C. La persistance de blocages insidieux D. L’enjeu de la qualité
- La mise en place d’une administration de l’économie de guerre
- Une économie mixte de guerre, entre politiques et patrons
- Une fonction de coordination entre dirigisme et liberté d’entreprendre A. Stimuler les entreprises B. La cristallisation des organismes patronaux
- Une puissance industrielle dualiste Conclusion
Chapitre III. La montée en puissance du système productif de guerre articulé autour de l’artillerie
- Les premières étapes du déploiement de l’industrie de l’artillerie (1914-1916) A. Le bond des besoins entre 1914 et 1916 B. L’essor de l’artillerie lourde C. La mutation des mortiers D. La définition d’un schéma d’ensemble en juillet 1916 E. L’artillerie n’est pas la panacée : les exemples de la Somme et du Chemin des Dames en juin-juillet 1916 et avril 1917
- La guerre du feu intense : la montée en puissance A. Une nouvelle impulsion donnée à l’artillerie en juin-juillet 1917 B. Les ultimes productions d’artillerie en 1918
- La double guerre des productions : faire du neuf, entretenir l’ancien
- La structuration d’un système productif articulé autour de l’artillerie A. Les arsenaux au coeur de la guerre industrielle B. Des établissements géants en région lyonnaise C. La vallée de la Basse-Seine dans la guerre industrielle D. Thomson-Houston, exemple emblématique de la mobilisation du secteur privé
- L’ingénierie industrielle en levier de l’efficacité A. Les aléas de la montée en puissance des chaînes de production B. L’enjeu des machines-outils Conclusion
Chapitre IV. Vers un déluge d’obus
- Produire des obus en masse A. Une montée en puissance difficile B. Le système productif des obus de plus en plus structuré
- Les arsenaux dans la guerre des obus
- Le secteur privé mobilisé pour les obus A. L’essaimage de l’industrie des obus B. Des entreprises reconverties dans les fabrications d’artillerie. C. Un mini-système productif en région parisienne D. L’essaimage au sein de mini-systèmes productifs régionaux..
- Un déluge d’obus
- Les retombées de la guerre des obus sur des branches latérales A. Les mécaniciens au service de la guerre des obus B. Les emballeurs, rouages modestes mais essentiels
Chapitre V. Les batailles industrielles en 1916 : enjeux, initiatives et blocages
- Les conséquences immédiates de la bataille de Verdun
- La bataille de l’industrie des armements
- La mise en oeuvre du programme de mai-juin-septembre 1916
- Innover au son du canon en 1916 A. L’entrée dans l’ère des véhicules de guerre B. L’importance des armements légers C. Le décollage de l’équipement aéronautique
- Une économie mixte équilibrée ? Conclusion
Chapitre VI. L’élargissement de la diversité des productions d’armements
- L’enjeu des armements légers
- L’enjeu des cartouches
- L’enjeu des grenades à main
- L’enjeu des mitrailleuses
- L’enjeu des chars : une lente maturation stratégique A. Des cuirassés terrestres en appui aux assauts de l’infanterie B. La percée des chars d’assaut C. Le triomphe des chars légers type Renault D. Une usine Berliet pour des chars E. Une esquisse de bilan technique de la guerre mécanique
- L’enjeu des innovations en optique Conclusion
Chapitre VII. Schneider en guerre
- Déjà un complexe militaro-industriel à la veille de la guerre A. La poursuite des programmes d’artillerie B. La cristallisation d’un bloc amont-aval
- La mobilisation industrielle en 1914 A. La mise en place de l’action de guerre B. L’afflux des commandes de guerre
- La poussée de l’industrie lourde en 1915-1918 A. Le renforcement du pôle du Creusot B. Schneider glisse plus encore vers la Normandie
- Schneider dans la guerre de l’artillerie
- Schneider entraînée par la guerre des obus
- Schneider face à la crise des transports
- La révolution électrique accélérée par la guerre ?
- Schneider engagée toujours plus dans l’industrie des transports..
- Innover dans la gestion de firme A. Un état-major civil dans la guerre B. L’évolution du mode d’impulsion et de contrôle C. Une gestion plus fine des ressources humaines
- Considérations sur la situation bilancielle de Schneider au sortir de la guerre Conclusion Annexe. Discours d’Albert Thomas chez Schneider en avril 1916 197
Chapitre VIII. Une guerre économique discrète, en amont de la production d’armements
- Une course à l’acier
- Un équilibre délicat entre importations et production nationale.
- Une course au charbon
- L’énergie électrique dans la guerre industrielle A. Les investissements en hydroélectricité B. Vers une économie mixte de l’électricité
- La bataille de l’électrométallurgie
- Le bond de la chimie en guerre A. L’émergence d’une chimie de guerre B. La chimie classique mobilisée : la chimie des poudres C. Surmonter la dépendance initiale vis-à-vis des technologies allemandes D. La bataille de la production d’explosifs et de gaz de combat : la percée de la chimie des gaz E. Les investissements en usines électrochimiques F. Saint-Gobain en action
- Produire pour la vie quotidienne des soldats Conclusion
Chapitre IX. Une course aux moyens de transport
- L’enjeu des camions de guerre
- Berliet, fer de lance des camions
- La course aux navires de fret
Deuxième partie La guerre de l’air gagnée aussi dans les usines
Chapitre X. La machine de guerre aéronautique en 1914-1919
- La conception de programmes aéronautiques A. Une esquisse de système d’aéronautique en 1914-1915 B. Les cafouillages de l’hiver et du printemps 1916 C. Une réelle mutation au tournant de 1917
- L’essor de l’industrie aéronautique A. Les ramifications de l’industrie aéronautique B. Les vibrations d’un système productif en décollage au second semestre 1914 C. Une courbe ascendante affirmée en 1915-1916 D. Une belle puissance de vol pour les conventions et contrats en 1917 E. Le boum de la production
- Un esprit d’entreprise et d’innovation
- Lyon pôle de production aéronautique
- La densification et la diversification de la filière amont
- Sans cesse innover tout en amplifiant la production Conclusion
Chapitre XI. L’Ouest parisien, coeur de l’aéronautique de guerre
- Hanriot, un pionnier mobilisé par l’effort de guerre
- Morane-Saulnier à Puteaux, des expérimentations aux séries A. Des marchés de part et d’autre de la déclaration de guerre B. L’explosion des commandes d’avions
- La montée en puissance de Caudron entre Issy-les-Moulineaux et Lyon A. Caudron, régulièrement au coeur des marchés publics B. D’énormes contrats en 1918
- Voisin, un acteur pluraliste de la guerre aérienne
- A Suresnes, la seconde aventure de Louis Blériot
- Nieuport, spécialiste des ... Nieuport, à Issy-les-Moulineaux
- Le décollage de Breguet à Villacoublay
- Une esquisse de bilan de la production des leaders de l’Ouest parisien
- Une floraison d’entrepreneurs en aéronautique de guerre A. Une première aventure militaire pour Marcel Bloch à Suresnes B. Un avioniste éphémère mais efficace à Levallois, Savary & De La Fresnaye C. Edmond de Marçay, de la mécanique aux SPAD à Paris 294 D. Lioré & Olivier, un sous-traitant destiné à une belle aventure après-guerre E. Farman, des équipements aux avions F. De petits fabricants insérés au fil de l’eau dans les commandes aéronautiques
- L’éclosion d’un mini-système productif local A. L’essaimage de l’industrie aéronautique autour du pôle de l’Ouest parisien B. Des fournisseurs de roues d’avion Conclusion
Chapitre XII. Bordeaux, nouveau pôle de l’aéronautique en 1914-1919
- Des entreprises descendues de Paris A. La mobilisation pour produire des avions B. Le boum de la sous-traitance en provenance de la région parisienne
- La mobilisation d’entreprises girondines A. Des ateliers dans l’agglomération bordelaise B. Des ateliers sur le bassin d’Arcachon C. L’industrie pétrolière mobilisée Conclusion
Chapitre XIII. La double montée en puissance des moteurs d’avion
- La double montée en puissance des moteurs
- Des moteurs Rhône fabriqués à Paris
- Une vedette de l’aéronautique lyonnaise : Salmson A. L’engouement pour les moteurs Salmson B. Des équipements variés C. Des avions Salmson s’envolent
Chapitre XIV. La mobilisation des mécaniciens de l’Ouest parisien pour les moteurs d’avion
- Clément-Bayard, de l’automobile à l’aviation à Levallois-Perret
- Clerget-Blin, un motoriste en essor à Levallois-Perret
- Hispano-Suiza, géant de l’industrie des moteurs d’avion à Bois-Colombes
- Lorraine-Dietrich, grand des moteurs pour hydravions à Argenteuil
- Mayen, un motoriste méconnu à Suresnes et Clichy
- Le système productif spécifique des motoristes
- Le sort des motoristes en jeu au tournant de 1919 Conclusion
Troisième partie La guerre des banquiers
Chapitre XV. Le soutien de l’effort de guerre des entreprises par les banques françaises en 1914-1918
- Une première étape : l’assouplissement du moratoire
- Les affaires de crédit internationales au service de l’industrie de guerre A. Les banques engagées dans de grands crédits transatlantiques B. Les banques engagées dans les crédits transatlantiques du groupe Schneider C. De petits crédits complémentaires
- Les banques et le montage de crédits européens A. Des crédits scandinaves B. Une série de crédits hollandais C. Des emprunts en Suisse D. Un crédit espagnol de douze tranches
- Des banques en guerre au financement de l’économie de la paix
Chapitre XVI. Les banques dans la propagande financière et patriotique
- Communication, confiance et persuasion
- Collecter les actifs disponibles
- Une machine à placer les bons d’Etat
- Les banques, actrices du placement des grands emprunts de guerre A. Un emprunt de paix émis juste à temps (juillet 1914) : la prise de conscience d’un besoin de propagande B. Le premier emprunt de guerre C. Le deuxième emprunt de guerre D. Le troisième emprunt de guerre E. Le quatrième emprunt de guerre
- L’art de la propagande et la propagande par l’art
- La propagande en action sur le terrain A. Des campagnes d’affichage B. La prospection des clients
- Une évaluation de la contribution à la mobilisation de l’épargne Conclusion
Chapitre XVII. La Société générale mobilisée dans la Première Guerre mondiale
- L’inflexion de la stratégie internationale de la Société générale A. Une vive croissance dans les années 1890-1910 B. Un modèle stratégique disloqué par la Première Guerre mondiale C. De bonnes occasions de rebond à l’international
- La mobilisation de la Société générale dans la guerre financière
- L’engagement en direct de la Société générale dans le soutien du Budget de guerre
- L’implication de la Société générale dans la machine industrielle de guerre
- Financer les importations par le négoce portuaire Conclusion
Quatrième partie La guerre de la logistique et du négoce
Chapitre XVIII. Worms en 1914-1918 : gérer la logistique en guerre internationale
- Une maison représentative du capitalisme familial
- L’économie maritime de Worms confrontée à la guerre A. Les aléas banals de la guerre B. Les incertitudes quant aux disponibilités de la flotte de commerce C. Worms dans la guerre sous-marine D. Une centralisation croissante
- Worms, l’un des pivots de l’axe franco-britannique
- Worms et l’économie du ravitaillement de guerre
- Vers la décentralisation de la manutention et du transit portuaires Conclusion
Chapitre XIX. Des maisons de négoce euro-africaines confrontées à la Guerre de 1914-1918
- Les turbulences provoquées par la guerre A. La crise des transports maritimes B. La crise des ponctions de cadres et d’employés
- Une inflexion provisoire du système productif euro-africain ? A. Les tensions de l’économie de marché B. Vers une économie mixte ?
- Vers une reconfiguration du modèle marchand euro-africain ? A. Un match entre forts et faibles ? B. Le redémarrage des affaires en 1916-1918 avant un boum en 1919-1920 C. L’argent du négoce de guerre
- Préparer l’après-guerre : une esquisse d’industrialisation ?
- A l’assaut des ex-colonies allemandes ? Conclusion
Chapitre XX. Le canal et la Compagnie de Suez face aux défis géopolitiques, maritimes et économiques de la Première Guerre mondiale
- Le canal, de la coopération d’affaires à un enjeu géopolitique
- Les effets économiques de la guerre sur l’entreprise de Suez
- Le canal de Suez en guerre A. L’isthme de Suez comme enjeu géopolitique B. La défense immédiate du canal de Suez C. L’isthme de Suez comme un levier pour des offensives britanniques en Palestine Conclusion
Conclusion générale
- Réflexions sur la République économique
- Réflexions sur le temps de l’action des entreprises
- Quelle République économique ?
- La guerre de l’innovation A. L’innovation industrielle B. L’innovation bancaire
- L’enjeu de la puissance économique : des batailles économiques de guerre à la bataille économique dans la paix
Index
Liste des légendes
-
Le Monde Livres, 22 mars 2018.
-
Revue du Nord, t. 100, n°425, avril-juin 2018
-
Le Monde, 20/03/20
-
Le Monde Livres, 22 mars 2018.
-
Revue du Nord, t. 100, n°425, avril-juin 2018
-
Le Monde, 20/03/20
- Présentation
- Sommaire
- Presse et annexes gratuites